For a sociohistory of science and technology: participants and spaces for the production and transmission of knowledge, from higher education to scientific conferences
Pour une sociohistoire des sciences et des techniques : acteur·rices, espaces de production et de diffusion des savoirs de l'enseignement supérieur aux congrès scientifiques
Résumé
Abstract: This habilitation to supervise research is threefold: first, a report summarizing and retracing all the research carried out prior to the doctoral thesis until now, while putting it in the biographical perspective of the author, then a selection of various papers, and an unpublished report.
The latter volume focuses on the French scientific congresses, founded by Arcisse de Caumont in the first part of the 19th century. Focusing on the first period of their existence (1833-1861), the research examines the role of provincial learned societies in structuring communities and their activities, and opens discussion on the challenges of disseminating and renewing knowledge. It follows up from earlier work on the role of these learned societies in setting up and disseminating courses and training outside the university in the 19th century. The aim is to complement a highly centralized reading of scientific production in the 19th century, which is otherwise very detailed. Based on a systematic study of conference proceedings, the dissertation provides a sociogenesis of this political project,which sought to ensure the visibility of provincial scholarly activities, and to coordinate and pass on their work. It points to the ambivalence between a desire for autonomy from Parisian institutions and a desire to enlighten and influence the authorities on the reforms to be carried out. By decentering the focus from Paris, it brings to light the specific ways in which intellectual work is structured. More specifically, it shows the effects of the practical organization of congresses on learned societies and on the towns that host these congresses, as well as on the knowledge produced. A number of particularly pressing concerns emerge from an analysis of these reports, such as education, particularly agricultural education, and social issues. The knowledge shared and transmitted at these congresses is analyzed through the prism of issues favored by congress participants, such as changes in French society, and the government of individuals and society. They are also analyzed from the point of view of the scientific operations and practices they describe, such as collecting, classifying and preserving.
Cette habilitation à diriger les recherches est composée de trois volumes : un mémoire de synthèse situant les travaux produits dans la trajectoire biographique de son autrice, depuis ceux réalisés en amont de la thèse jusqu’aux plus récents, un recueil de travaux et un mémoire inédit.
Ce dernier volume porte sur les congrès scientifiques de France, fondés par Arcisse de Caumont dans la première partie du XIXe siècle. Circonscrite, à une première période de leur existence (1833-1861), la recherche interroge le rôle des sociétés savantes de province dans la structuration des communautés et de leurs activités, et ouvre la discussion sur les enjeux de diffusion et de renouvellement des savoirs. Elle a été engagée à la suite de travaux antérieurs, sur le rôle de ces sociétés savantes dans la mise en place et la diffusion de cours et formations créés au XIXe siècle en dehors de l’université. Elle vise à compléter une lecture très centralisée de la production scientifique au XIXe siècle, par ailleurs très détaillée. S’appuyant sur l’étude systématique des comptes rendus produits à l’occasion des congrès, le mémoire produit une sociogenèse de ce projet politique qui revendique à la fois d’assurer une visibilité aux activités savantes de province, de coordonner et de diffuser leurs travaux. Il pointe l’ambivalence entre une velléité de s’autonomiser des institutions parisiennes et la volonté d’éclairer et d’influencer les autorités sur les réformes à mener. En décentrant le regard de Paris, il met au jour les formes spécifiques de structuration du travail intellectuel. Plus précisément, il montre les effets de l’organisation concrète des congrès sur les sociétés savantes et sur les villes qui accueillent les congrès mais aussi sur les savoirs produits. Plusieurs préoccupations particulièrement prégnantes ressortent de l’analyse de ces comptes rendus, ainsi en est-il de l’enseignement, notamment l’enseignement agricole, et de la question sociale. Les savoirs échangés et diffusés à l’occasion de ces congrès sont analysés au prisme des questionnements privilégiés par les congressistes, comme les mutations de la société française, le gouvernement des individus et de la société. Ils le sont également du point de vue des opérations et pratiques scientifiques qu’ils décrivent comme la recension, le classement et la préservation.
Fichier principal
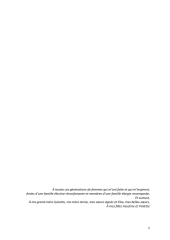 vol 1 texte.pdf (1)
Télécharger le fichier
Vol 1 couverture.pdf (86)
Télécharger le fichier
Vol 1 dos.pdf (56)
Télécharger le fichier
vol 1 texte.pdf (1)
Télécharger le fichier
Vol 1 couverture.pdf (86)
Télécharger le fichier
Vol 1 dos.pdf (56)
Télécharger le fichier
| Origine | Fichiers produits par l'(les) auteur(s) |
|---|
| Origine | Fichiers produits par l'(les) auteur(s) |
|---|


